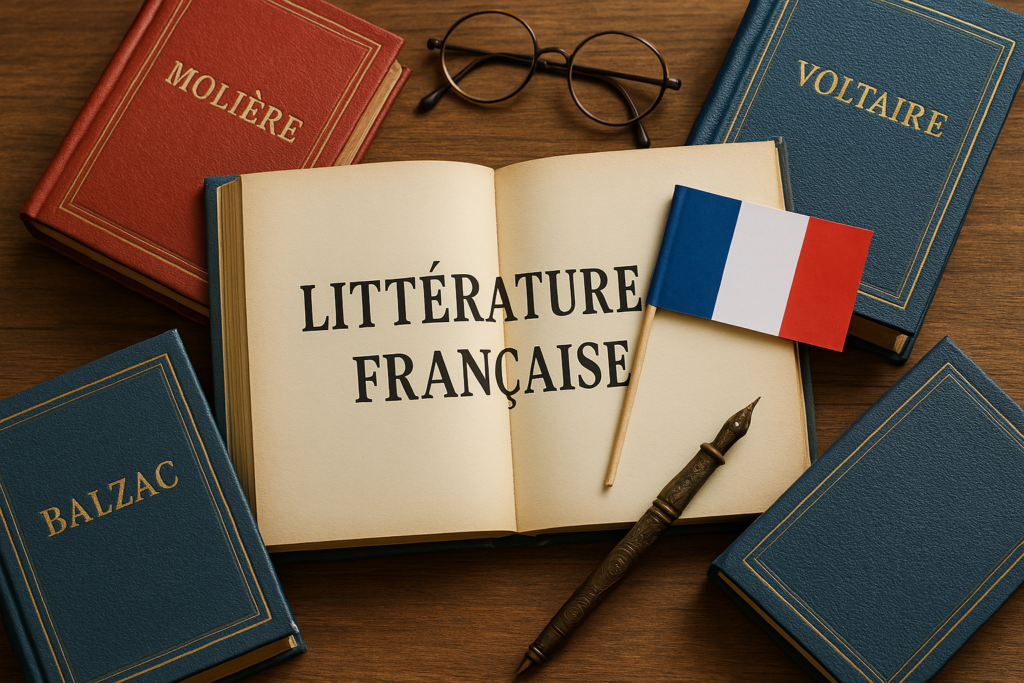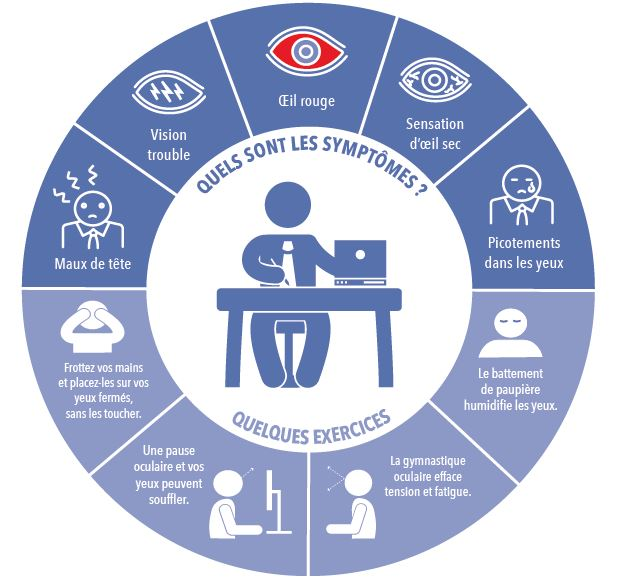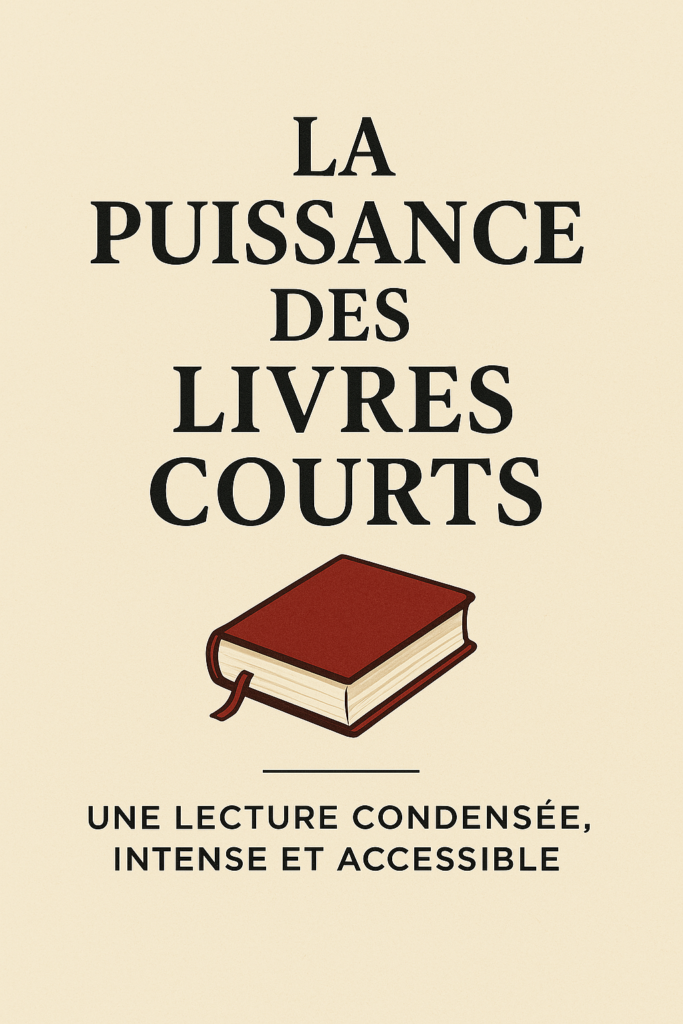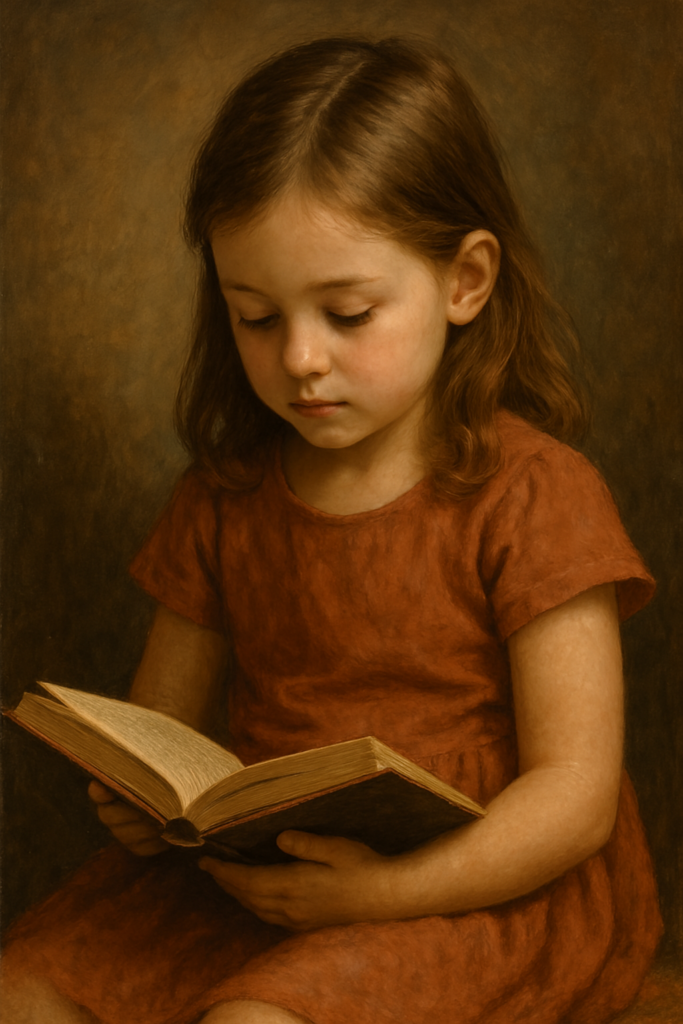Les styles littéraires sont fréquents dans les livres parce qu’ils permettent de sublimer le langage, de l’embellir, de transmettre des émotions profondes et de donner à chaque auteur une voix unique. Le style littéraire transforme une simple narration en une expérience sensorielle et intellectuelle, jouant sur les rythmes, les images, les métaphores ou même les silences. C’est un moyen puissant de marquer les esprits, d’enrichir la lecture et de conférer à chaque œuvre une identité singulière.
Cependant, malgré leur richesse, ces styles peuvent parfois rendre la lecture moins accessible. C’est une réalité que j’ai souvent rencontrée en tant que lecteur. Issu d’un cursus scientifique et diplômé d’un Bac +4 en mathématiques, la littérature n’a jamais été mon terrain de prédilection — même si, avec le temps, j’ai fait des progrès notables. Je ne serais pas incapable d’adopter un style plus littéraire, mais cela me demanderait un investissement considérable… et, honnêtement, je n’en aurais ni le temps ni l’envie.
Il m’arrive, ponctuellement, d’employer ce type de langage pour décrire quelque chose de beau ou traduire une émotion forte. Mais de manière générale, je privilégie un ton neutre, clair et surtout accessible. Un style trop dense, aux phrases interminables ou aux métaphores alambiquées, peut décourager certains lecteurs, ralentir le rythme narratif ou même brouiller le message. À mes yeux, un bon récit ne doit pas être un labyrinthe, mais un chemin ouvert.
C’est pourquoi je veille à ce que mes récits parlent à chacun, tout en guidant le lecteur pas à pas, sans jamais le perdre en route.